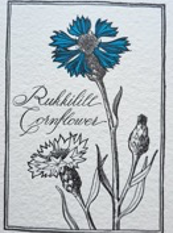L’origine de cet élan musical remonte aux XIXe siècle. Dans le sillon du mouvement spirituel luthérien inspiré des Frères Moraves et de l’éveil national du pays, les estoniens se rassemblèrent alors pour chanter ensemble des hymnes surtout religieuses. Aujourd’hui, à l’aune de la sécularisation du pays, le programme est dominé par des chants profanes mais la dimension spirituelle y trouve tout de même une place, tel un Ave Maria, impeccablement repris en chœur par 134 chorales et 3970 chanteurs ou telle une hymne composée pour l’occasion par Margo Kõlar sur des paroles en ancien estonien :
Oh Aadam sino essitüs
Le compositeur, qui joue un rôle majeur dans l’animation de la communauté catholique au monastère des Brigittines de Pirita, l’accompagne de sa cornemuse. Le charismatique Pärt Uusberg avait clairement beaucoup de joie à pouvoir diriger ce cantique.
Les enfants ne sont pas oubliés. Ils ont exercé leurs chants pendant des mois à l’aide de vidéos envoyées aux quatre points du pays. Tous les chants ne sont pas en estonien. Les enfants ont ainsi repris un chant dans la minuscule langue ouralienne parlée dans la région de Võru, au sud-est du pays : Esä taivan
(Musique de Mari Amor (°1973) sur un texte d’Artur Adson (1889-1997)). Je ne puis vous priver de son texte :
Esä taivan,
tii’ nii, et latsil,
kiä hummuku kuuli rühkvä’,
takan abitu’ patsi’,
iin sinitse’ nõnaksõ’,
huulil poolõlõ opitu’ sõnaksõ’,
et latsil, kiä hummuku läävä’ kuuli,
vähämb puhus näkku tuisku ja tuuli.
Tii’ ka nii, et vihma nii pall´o ei satas,
tii’ ka nii, et lummõ nii rohkõst ei satas,
ent kui siski sa-i saa’ ilma suurõmba saota,
sõs suurilõ rohkõmb, vähämb latsilõ jaota!
Père céleste,
Fais que les enfants
qui vont à l'école le matin,
avec des tapes impuissantes dans le dos,
des nez bleus devant,
et des manières à moitié apprises sur les lèvres,
fais en sorte que les enfants qui vont à l'école le matin
aient moins de vent et de bruine dans la figure.
Faites qu'il pleuve moins,
Faites qu'il neige moins,
mais si vous ne pouvez pas vous passer de plus de
pluie, donnez-en plus aux grands, moins aux enfants.
En visionnant la prestation de ce chant par 188 chorales et 6244 enfants au Laulupidu 2025, vous pourrez non seulement vous rendre compte de l’élégance du chef de choeur Raili Kaibald mais aussi de la ferveur de ces enfants et des conditions atmosphériques dans lesquelles s’est déroulé le festival cette année, en symbiose avec ce chant… : lien youtube
Le choix des chants programmés dit à chaque fois quelque chose de l’état du pays. C’est ainsi que lors du Laulupidu précédent, une chanson a particulièrement ému les estoniens. Il revenait à Siiri Sisask de chanter la musique qu’elle a composée sur un poème d’un des grands poètes estoniens Eduard Vilde (1865-1933). Le texte évoque les impressions d’une nounou française appelée à s’occuper d’une famille en Estonie. Dépaysée dans ce pays étrange, elle se demande où elle a abouti et surtout, alors qu’il a bien peu de charmes apparents, pourquoi elle s’y est attachée et y reste. Mis maa see on ? Quelle est donc cette terre ? Dans ce pays, il n’y a pas de montagnes, uniquement des marécages, des jours et des nuits qui n’en finissent pas ; un pays où la population est astreinte à un dur labeur pour juste survivre, où la justice défaille, où les émotions ne s’expriment pas… et pourtant cette nounou y reste.
Vous pouvez écouter ce chant et voir un des rares moments où les estoniens expriment leurs sentiments, cette année-là sous un ciel serein, sur : lien youtube
Ces paroles ont touché les estoniens qui voient tant de leurs compatriotes quitter leur pays pour trouver des conditions de vie meilleures ailleurs. L’émigration et la démographie sont en effet parmi les défis majeurs du pays qui m’accueille. La situation économique avec des salaires qui ne sont pas à la hauteur du coût de la vie, une inflation à plus de 5%, des taux de taxation et de TVA (24%) uniques pour financer les 5,4% du BIP consacré à la défense et les incertitudes liées à la situation géopolitique poussent surtout les jeunes diplômés à chercher leur bonheur ailleurs. Pour une petite culture comme l’estonienne, cela engage sa survie.