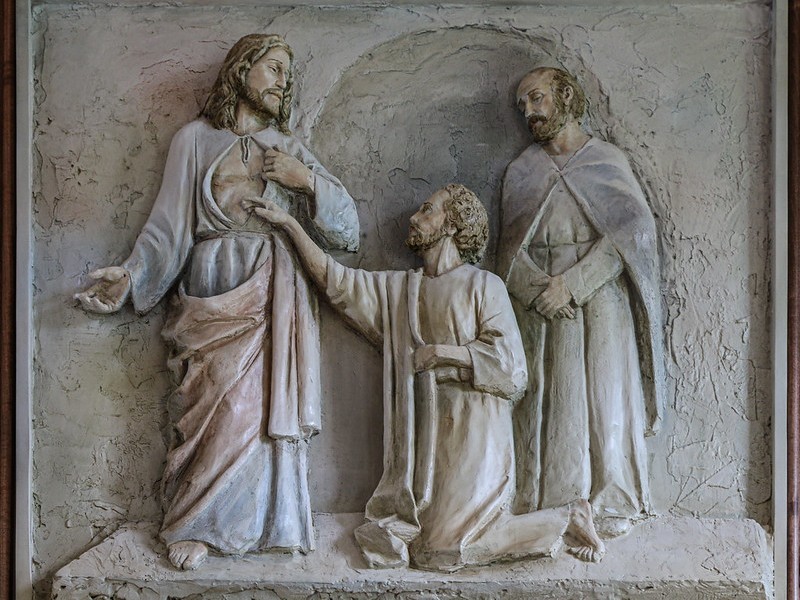Des apôtres et des miracles (Actes des Apôtres 5, 12-16)
À Jérusalem, par les mains des apôtres, beaucoup de signes et de prodiges s’accomplissaient dans le peuple. Tous les croyants, d’un même cœur, se tenaient sous le portique de Salomon. Personne d’autre n’osait se joindre à eux ; cependant tout le peuple faisait leur éloge ; de plus en plus, des foules d’hommes et de femmes, en devenant croyants, s’attachaient au Seigneur. On allait jusqu’à sortir les malades sur les places, en les mettant sur des civières et des brancards : ainsi, au passage de Pierre, son ombre couvrirait l’un ou l’autre. La foule accourait aussi des villes voisines de Jérusalem, en amenant des gens malades ou tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris.
Chaque année, la première lecture proposée du 2e dimanche de Pâques est un passage du début des Actes des Apôtres qui décrit, sous forme de sommaire, la première communauté qui s’est formée à Jérusalem à la suite de l’annonce par les disciples de la résurrection de Jésus, le jour de la Pentecôte. Comme le livre des Actes compte trois sommaires de ce genre, il y en a un pour chaque cycle de lectures. Chacun insiste sur un aspect particulier de la vie communautaire : l’unité et le rayonnement des chrétiens (2,42-47, année A), la mise en commun volontaire des biens (4,32-35, année B) et les miracles qui manifestent la crédibilité des apôtres et de leur proclamation (5,12-16, année C). D’autres traits complètent ces thèmes principaux : l’assiduité à écouter l’enseignement des apôtres et la prière, l’agrégation de nouveaux croyants, le respect inspiré par la communauté.
En général, le thème dominant du sommaire est illustré par l’un ou l’autre épisode du début du livre. Pour ce qui est des miracles qui sont au centre du 3e sommaire, une guérison a déjà été racontée : celle d’un infirme de naissance qui mendiait à la porte du temple (Ac 3,1-10). Pour Pierre et Jean, cela a été l’occasion d’annoncer la résurrection du Christ qui a rendu la santé à l’homme guéri (3,11-26), mais aussi de rendre témoignage à leur maître devant les autorités judéennes qui prennent ombrage de leur succès (4,1-21). Au cours de la prière d’action de grâce pour la libération de Pierre et Jean, la communauté demande à Dieu d’étendre la main « pour que se produisent des guérisons, des signes et des prodiges par le nom de Jésus » (4,30). Ce qui est relaté dans le sommaire constitue la réponse de Dieu à la prière de la communauté. Le succès des apôtres relaté à la fin du sommaire a une conséquence inattendue : les autorités religieuses du peuple arrêtent les apôtres et les emprisonnent au vu et au su de tous, espérant sans doute les décrédibiliser. Miraculeusement libérés, ils se remettent à enseigner le peuple. Arrêtés de nouveau, ces hommes qui « préfèrent obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes » (5,29) en profiteront pour témoigner de l’exaltation par Dieu de celui que les chefs du peuple ont fait mourir en croix (1re lecture du 3e dimanche de Pâques C).
Manifestement, Luc, l’auteur des Actes, tient à montrer que « le disciple n’est pas au-dessus du maître » (Lc 6,40). Se réalise ainsi la parole de Jésus : « On mettra la main sur vous et l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous traînera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous donnera une occasion de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préparer votre défense, car je vous donnerai des paroles et une sagesse telles qu'aucun de vos adversaires ne pourra s'y opposer ni les contredire. » (Luc 21,12-15). Dans ce cadre, le sommaire met en évidence la similitude entre le maître et les disciples. De son vivant, Jésus a manifesté la proximité de Dieu par des miracles : après sa résurrection, les apôtres font de même, tout en mettant en évidence la fécondité de la mort de Jésus. Les miracles de celui-ci attiraient les foules de sorte qu’il pouvait les enseigner (Luc 4,40 ; 5,15). Il en va de même pour les apôtres après la résurrection. Ces mêmes miracles valaient-ils à Jésus critiques et condamnations de la part des autorités religieuses (Luc 6,7.11) ? Les apôtres font la même expérience, à la suite de leur maître. Dans la vie de la jeune Église, c’est bel et bien l’aventure de Jésus qui se poursuit.