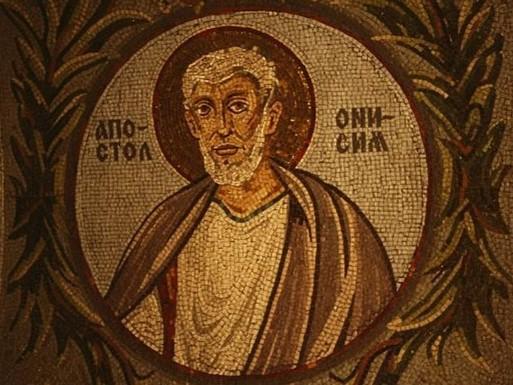Devenir disciple (Luc 14,25-33)
De grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi et ne hait pas son père, et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne se charge pas de sa croix pour venir derrière moi ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s’asseoir pour calculer la dépense, s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais, une fois qu’il a posé les fondations, il n’est pas capable d’achever, tous ceux qui verront commenceront à se moquer de lui en disant : “Voici quelqu’un qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !” Ou quel roi, partant en guerre contre un autre roi, ne s’assied pas d’abord pour voir s’il est capable, avec 10 000 hommes, d’affronter celui qui marche contre lui avec 20 000 ? Si ce n’est pas le cas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. »
L’évangile de Luc a beau être celui de la miséricorde divine, il sait aussi se faire exigeant quand il s’agit de mettre en lumière les choix radicaux que requiert une vie évangélique. Le texte proposé pour ce dimanche est un modèle du genre. Selon le récit de Luc, Jésus est en route vers Jérusalem où s’accomplira son « exode » – son passage vers la vie à travers la mort (Lc 9,31.51). Il est accompagné par des foules nombreuses qui, en le suivant, se comportent comme des disciples, mais ignorent sans doute tout de l’adversité à laquelle Jésus s’expose là où il a choisi d’aller. Il met donc les choses au point. Le suivre demande lucidité et réflexion sur le type d’engagement que cela implique et sur la capacité que l’on a d’assumer un tel engagement. Tel est le sens des deux petites paraboles de l’homme qui décide de bâtir une tour ou du roi qui envisage de partir en guerre. Au début et à la fin de ce passage, Jésus expose clairement ce que devenir disciple exige : essentiellement se faire libre de tout ce qui peut entraver l’adhésion à lui.
D’une part, il y a les liens familiaux : « haïr » les membres de sa famille (la traduction liturgique édulcore : « sans me préférer à son père… »). Le verbe ici employé relève probablement du vocabulaire de l’alliance, où « aimer et haïr » ne se réfèrent pas à des sentiments, mais à un choix prioritaire de fidélité (voir par ex. dans le décalogue, Exode 20,5-6 où « haïr Dieu » signifie ne pas être fidèle à l’alliance avec lui). Ici, Jésus réclame que ce soit la fidélité à lui qui régisse les autres relations dans lesquelles le disciple est impliqué. Les relations familiales peuvent emprisonner, être paralysantes. Jésus lui-même, d’ailleurs, les fait passer clairement au second plan, quand il déclare que « [s]a mère et [s]es frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et la mettent en pratique » (Luc 8,19-21). Donner priorité à Jésus et à sa parole, c’est dès lors aussi renoncer à soi-même, à cette image de soi qui s’est construite au sein de ces relations proches ; c’est trouver une identité nouvelle dans le devenir disciple de l’Évangile.
D’autre part, il y a les biens que l’on possède et qui sont autant de pièges : la richesse peut emprisonner la personne, la rendre esclave, la priver d’elle-même – alors même qu’un riche pense sans doute qu’elle garantit sa vie et son futur. Le Jésus de Luc met sévèrement en garde contre le risque d’esclavage que la richesse fait courir, lorsqu’il déclare en 16,13 (aussi Mt 6,24) : « Aucun domestique ne peut servir deux maîtres : ou bien il haïra l’un et aimera l’autre [au sens précisé ci-dessus], ou bien il s’attachera à l’un et méprisera l’autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon ». C’est ce qu’il illustre par la parabole du riche et de Lazare (Luc 16,19-31) où il montre à quel aveuglement mais aussi à quel malheur la richesse peut conduire.
Si l’on en croit la répétition de la formule « il ne peut pas être mon disciple », c’est cette double renonciation à ce qui risque d’empêcher la liberté intérieure qui est visée par l’expression « se charger de sa croix ». En effet, un tel choix peut être pesant, déchirant, voire crucifiant. Il implique une forme de mort à soi-même, à l’image de Jésus qui s’est dépouillé de lui-même jusqu’à la mort de la croix (lettre de Paul aux Philippiens 2,7-8). Aussi, pour Luc, devenir disciple n’est pas fait pour les foules, pour ceux et celles qui se contentent de suivre un mouvement. Ce n’est possible que pour les gens qui sont prêts à des ruptures, à des renoncements pour s’attacher personnellement à Jésus.